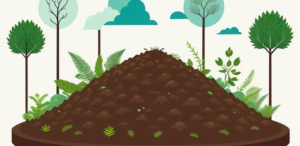Arnaud Florentin, économiste : « Et si l’antidote à l’urgence climatique était la diversité économique » ?

Arnaud Florentin est économiste et directeur associé du cabinet Utopies. Après avoir travaillé près de 20 ans sur les problématiques d’économie locale, le constat qu’il dresse est sans appel : nos économies n’ont jamais été aussi optimisées, et pourtant, nos territoires sont terriblement démunis face au dérèglement climatique. Alors que nous cherchons à imiter la nature, sa qualité première, la diversité, est en voie de disparition au sein de nos industries. En quête de solutions, ses travaux de recherche le conduisent à trouver dans les forêts tropicales un puissant cadre d’inspiration. Arnaud Florentin nous partage son analyse dans un essai important et accessible, dont François Gemenne, membre du GIEC, signe la préface. Entretien.

L’économie étant souvent présentée comme un problème plutôt qu’une solution, c’est un prisme que l’on a peu l’habitude d’entendre. Pourquoi l’avoir choisi ?
Tout à fait. Malheureusement, lorsque les économistes prennent la parole, on reste beaucoup dans l’idée de « faire du climat un marché », avec le marché du prix du carbone, les compensations carbone, etc. C’est un sujet intéressant et très important. Mais l’idée, c’était de se dire que l’économie, ce n’est pas que ça. Il y a tout un tas d’essais sur la décroissance et d’autres sujets, moins sur la question des territoires, sur la manière de s’y prendre, la manière dont on s’en sort. C’est ce qui m’a motivé à écrire ce livre. En tout cas, l’une des raisons, c’est qu’effectivement, on n’aborde pas forcément la question climatique sous l’angle économique. Et quand c’est le cas, ce n’est pas toujours sous l’angle des territoires.
Vous commencez l’essai en évoquant les « Cygnes noirs » de Nassim Nicholas Taleb, ces événements rares et extrêmes qui vont se matérialiser plus fréquemment avec le dérèglement climatique. Pourquoi des entreprises qui, pour la plupart, étudient les risques, et qui ont finalement tout intérêt à être robustes, résilientes, antifragiles, ne sont-elles pas encore suffisamment embarquées dans une démarche de prévoyance ? Qu’est-ce qui bloque ?
Notre économie semble parfaitement huilée, optimisée, avec des chaînes de valeur très fragmentées qui semblent bien fonctionner. On a des économies d’échelle, une très forte spécialisation des territoires, voire même une très forte concentration de la production dans certains sites. Il est très difficile de sortir de ce mode de fonctionnement international parce que beaucoup y gagnent. Mais en même temps, ce modèle nous rend de plus en plus fragiles. Pour reprendre l’image de Taleb que j’évoque dans le livre, on a un cinéma qui est de plus en plus beau, de plus en plus grand, de plus en plus spacieux, qui donne envie de rentrer dedans, avec toujours autant de portes de sortie. Sauf que le jour où il y a un choc, tout le monde s’engouffre vers la même porte de sortie. Et malheureusement, c’est là qu’il y a un effet de pénurie.
Donc l’économie semble parfaitement performante et efficace, mais elle n’est pas efficiente. En cas de choc, elle n’est pas adaptée, malheureusement. Jusqu’à ce que les chocs interviennent, certaines entreprises n’ont pas intérêt (en tout cas c’est ce qu’elles pensent) à remettre en cause ces grandes chaînes de valeur. Même des logiques d’économie circulaire qui sont pourtant très vertueuses, sont aujourd’hui très mondialisées. Or on se rend compte que plus les Cygnes noirs arrivent, plus les dégâts sont importants. À chaque crise climatique – et on le voit tous les étés – les dommages augmentent de façon exponentielle. C’est là qu’il y a vraiment quelque chose à craindre.
Aujourd’hui, de nombreux territoires se vident de leur circuit économique local avec un schéma qui peut paraître absurde : les aires urbaines françaises exportent de 85 à 90 % de leur production industrielle et agricole, dans le même temps elles importent ces mêmes biens et dans les mêmes proportions. Pourquoi ce modèle nous rend particulièrement vulnérables face aux aléas climatiques ?
On s’est inscrit dans cette mondialisation avec une ultra-spécialisation. Pour prendre un exemple, une grande partie des céréales produites sur un territoire sont automatiquement exportées. À l’inverse, on importe tout un tas de ressources agricoles assez proches, que l’on pourrait produire sur place. Ce modèle fragilise les territoires parce qu’il y a un effet passoire : des richesses rentrent, mais ne circulent pas. À ce propos, la notion de métabolisme intervient de plus en plus dans les débats d’experts. C’est l’image d’un organisme qui reçoit de l’énergie mais qui ne la garde pas. En fait, l’énergie n’irrigue pas suffisamment le territoire. Ce n’est pas tant une « démondialisation » qui est aujourd’hui nécessaire, mais plutôt un rééquilibrage qui doit s’opérer. D’ailleurs, il y a une très grande partie des importations qui servent à produire des biens destinés à l’exportation, qui ne servent même pas le circuit économique local.
C’est un vrai problème en termes de souveraineté, de résilience, de circuits-courts, de réduction des distances de transport… Parce qu’en cas de choc, on ne sait plus imaginer des symbioses locales. Avant de diversifier, on pourrait par ailleurs densifier. Il y a peut-être des choses qui sont exportées que l’on pourrait garder sur le territoire. Dans le livre, je prends l’exemple des pâtes. Certes, il faut une certaine forme de céréale pour produire des pâtes, mais 60% de notre territoire agricole est couvert de céréales. En parallèle, on est le premier importateur de pâte au monde par tête. On a trois, quatre usines de pâtes et seulement quelques artisans pastiers alors que l’on dispose de la ressource. L’intérêt du rééquilibrage est de se dire que l’on peut recréer des filières locales.
Au contraire, plus un territoire est diversifié, moins sa propension à importer est forte, plus il a les clés pour agir sur les émissions de CO₂ qui jusqu’ici étaient invisibles. Est-ce que la relocalisation des activités productives et industrielles, c’est aussi un moyen plus juste de mesurer et d’améliorer son empreinte carbone ?
C’est un vrai sujet qui est pour moi un angle mort, qu’on ne voit pas ou qu’on ne veut pas voir : l’importance du local dans la question climatique. Quand on mesure son empreinte carbone, on mesure son empreinte carbone territoriale. C’est ce qui est émis depuis le territoire. La notion d’empreinte carbone qui inclut les émissions importées commence timidement à faire sa place depuis une dizaine d’années. Elle n’est malheureusement pas encore assez reconnue. Or, à la maille d’un territoire, on est entre 75 et 80 % des émissions qui sont importées, ce qui est considérable. Pour un territoire, agir sur sa stratégie climatique, c’est d’abord agir sur ses émissions importées. Sauf que – et le problème il est là – quand vous dites à un élu « Il va falloir que vous rapatriez les émissions de CO₂ sur votre territoire », il est réticent.
La difficulté du lien entre territoire et émissions de CO₂, c’est qu’elle est souvent réduite aux transports. Les transports, c’est important, mais ça ne reste qu’une petite part dans les émissions de CO₂ des biens manufacturés. Et deuxièmement, on la réduit au fait qu’on dispose d’une énergie moins carbonée qu’ailleurs. Ce que je montre dans le livre, c’est que le vrai enjeu du local, c’est d’accepter de ramener chez soi – en tout cas en théorie – des émissions qui sont émises ailleurs. Et tout l’intérêt de la réindustrialisation, c’est justement de ne pas faire comme ailleurs. Il ne s’agit pas de ramener une activité sur un territoire et de la reproduire de la même façon. Sinon, vous avez simplement un jeu de vases communicants. L’intérêt, c’est de fabriquer différemment, avec beaucoup plus de synergies, de mutualisation, de coproduits, de déchets, etc. Ça, c’est une question que l’on ne retrouve pas assez dans les discussions. Pourtant, tout le sujet est là. L’idée, c’est de repenser l’écologie industrielle et la manière dont on va pouvoir inscrire ces activités sur le territoire.
Vous avez constaté que moins le tissu économique d’une commune est diversifié, plus le score de Marine Le Pen a tendance à être élevé. Si l’on veut créer un nouveau projet de société, la démocratie et le « vivre ensemble » sont une absolue nécessité. En quoi la diversité économique est-elle déterminante sur ce sujet ?
J’ai effectué ce travail de corrélation lors des dernières élections. Je me suis aperçu que les scores extrémistes étaient très élevés dans les territoires qui avaient une diversité productive assez faible, avec une très forte monotonie économique ou historiquement spécialisés dans une activité. Que ce soit en France ou dans d’autres pays, il y a un sujet fondamental entre la diversité économique d’un territoire et l’équilibre démocratique. La dictature par exemple, n’aime pas la diversité. Parce que plus il y en a, plus le pouvoir économique au sein d’un territoire est distribué, plus c’est difficile de le contrôler.
Pour revenir à la fameuse corrélation entre les scores extrémistes, notamment de Marine Le Pen, et le niveau de diversité de l’économie, des recherches ont montré que les gilets jaunes étaient surtout présents dans des zones issues de la diagonale du vide. À l’inverse, le territoire de Cholet et des pays de Mauges par exemple, a très peu connu cette crise. Ce territoire est loin d’être le plus riche de France, mais c’est le plus égalitaire. Pourquoi ? Parce que c’est une « forêt productive ». C’est l’un des territoires les plus diversifiés économiquement de France. Cela veut dire que les habitants sont impliqués et trouvent une place dans l’économie.
D’autre part, plus vous diversifiez un territoire, plus vous avez également une diversité culturelle et socio-démographique. Plus vous avez une diversité de populations, de religions, de cultures sur un territoire, plus les personnes comprennent ce partage. La crise climatique va relancer les crises sociales de type gilets jaune. Il est notamment important que tous les territoires ruraux ou semi-ruraux se diversifient, avec davantage de diversité de population. Mais tant qu’on restera sur des territoires hyper spécialisés, on aura des territoires qui auront peu d’ouverture sociale, qui seront très exposés aux chocs et qui auront du mal à créer de la valeur économique.
Vous avez effectué d’importants travaux de recherche et identifié dix « forêts productives », qui ne constituent pas des modèles de développement mais qui sont quand même nettement en avance sur les autres. Si vous deviez nous résumer en quelques mots ce qu’est une forêt productive ?
Je suis parti du constat qu’on rencontrait des difficultés pour mettre en place des plans de transition et d’adaptation. Je me suis dit que le problème numéro un, c’était un problème de diversité économique. On essaie d’imiter la nature sans succès puisque l’on ne dispose pas de sa qualité première : la diversité. J’ai cherché un interprétant : les forêts productives, leur système immunitaire, la biodiversité et la diversité génétique. Je me suis dit que finalement, ce qu’il faudrait sur nos territoires, ce sont des forêts productives. C’est-à-dire une très grande diversité d’activités économiques sur un petit territoire. Je suis parti de cette hypothèse-là en me demandant si ce type de territoires existait déjà et s’ils faisaient la transition et l’adaptation plus facilement qu’ailleurs. C’est ça que j’ai cherché à comprendre et à développer.
Je suis donc parti à la recherche de forêts productives. Pour les identifier, j’ai utilisé la même technique que l’on utilise pour mesurer la biodiversité dans une forêt. J’ai utilisé des indicateurs similaires, sauf que j’ai remplacé les arbres par des activités économiques et les espèces d’arbres par des secteurs d’activité. J’ai pu identifier tout un tas de forêts productives dans le monde et notamment celle que je considère comme étant la plus belle : le territoire d’Holland aux Etats-Unis. Elle n’est pas très connue mais représente pourtant une vraie oasis économique et une vraie oasis de transition.
Pourquoi la forêt productive d’Holland est-elle particulièrement intéressante ?
C’est un territoire qui est dans le Michigan. La forêt productive prend racine dans cette petite ville d’Holland qui compte 33 000 habitants. Cette ville a été fondée par des immigrés hollandais, comme son nom l’indique. Elle a réussi quelque chose d’extraordinaire : sur ce territoire qui n’est pas très grand, on retrouve entre 150 et 180 secteurs d’activité différents. On y fabrique quasiment de tout. Ce territoire est le plus dense en termes d’industrie et le plus diversifié.
Ce qui est fascinant, c’est qu’il s’est développé petit à petit, comme une forêt se serait développée par ramification de manière quasi génétique. Ils ont fait ce que l’on appelle des « sauts productifs ». Ils avaient des ressources agricoles avec lesquelles ils ont créé une première diversité économique du territoire. Ensuite, ils ont exploré de nouvelles parcelles de la forêt productive. Ricardo Haussman, économiste de l’Université d’Harvard, utilise l’analogie des singes qui explorent, en allant d’arbre en arbre. Ils n’ont pas fragmenté leur forêt, ils ont toujours préservé le patrimoine.
Holland est aussi considéré comme l’une des plus belles villes des États-Unis, l’une des plus heureuses et l’une des mieux placées dans les classements de gestion de l’environnement. C’est le territoire qui est aujourd’hui quasiment en tête de l’autonomie alimentaire aux États-Unis, qui a peut-être l’un des plus beaux projets d’écologie industrielle, qui a été l’un des plus résilients dans la crise Covid, qui présente le moins d’inégalités au niveau national et même, le moins de syndicats. C’est un territoire qui a développé une forme de prospérité locale, qui est en avance sur la transition et qui est prêt pour faire l’adaptation. En cas de choc, une forêt tropicale est très résiliente. C’est ce qui se passe avec ce territoire d’Holland, mais il y en a d’autres. C’est ça l’esprit des forêts productives.
Avec une identité très marquée, un héritage commun structurant, un important réflexe de coopération, une certaine éthique du bien commun, une mutualisation des ressources ou des unités de production… Est-ce que c’est la fin d’un modèle ultra concurrentiel et le début d’un modèle plus collaboratif entre les entreprises ?
Si je me fie par biomimétisme aux forêts, c’est à la fois un modèle de concurrence et de coopération. Dans une forêt, il y a des systèmes de concurrence permanents entre les entreprises et en même temps, il y a une logique de coopération, de synergie d’échanges. On retrouve les deux. Quand je dis « coopération », ça peut être aussi, par exemple, des salariés qui développent des spin-offs. On retrouve beaucoup cela à Cholet. Des salariés de l’entreprise créent leur propre entreprise et étendent la forêt productive. Mais ça n’éteindra jamais la concurrence. D’ailleurs, les forêts productives sont hyper compétitives et c’est à la fois la concurrence interne et la coopération qui permet cela.
L’écologie forestière est un puissant cadre d’inspiration et de représentation, quitte à ne pas être toujours parfaitement optimale. Est-ce que les entrepreneurs, qui ont un rôle essentiel dans l’émergence de forêts productives, ne sont pas freinés par les modèles de réussite qui sont justement basés sur l’optimisation à outrance, mais aussi la croissance rapide, l’innovation continue ?
En fait, c’est la notion de redondance et l’optimisation n’aime pas la redondance. Une forêt productive, ça ne veut pas dire avoir 100% de ses fournisseurs en local. Dans l’approche optimisée, on va avoir, par exemple, deux sites fournisseurs. Là, on a une vraie réflexion sur le fait d’en avoir d’autres plus près, mais surtout de pouvoir se dire « si j’ai un fournisseur en local qui est capable de produire 5 à 10% de ce dont j’ai besoin, cela me permet de faire face à des chocs temporairement ou durablement. » Et ce ne sont d’ailleurs pas nécessairement des entreprises qui sont déjà fournisseurs. Dans les forêts productives, il y a des tas d’exemples de structures qui, du jour au lendemain, ont perdu une source d’approvisionnement et se sont tournées vers des entreprises locales en leur demandant de monter dans leur chaîne de fournisseurs.
Il y a beaucoup d’entrepreneurs sur les territoires qui commencent à réfléchir à toutes les solutions d’approvisionnement local. C’est quelque chose qui commence à changer et qui a beaucoup freiné l’économie. On est vraiment rentré, comme je disais en introduction, dans une forme d’optimisation. Or il y a une différence entre l’optimisation et l’efficience. On peut optimiser les flux ou les stocks pour qu’il n’y ait pas de surplus, pas de gâchis, de gaspillage, etc. Malgré tout, nos systèmes de production sont très loin d’être efficients. Il y a des déchets et des coproduits qui ne sont pas du tout utilisés, des usines qui fonctionnent parfois à 60-70% de leurs capacités, des salariés qui sont malheureusement employés à temps partiel alors qu’ils pourraient partager une partie de leur temps dans une autre entreprise, des matériels dans les usines qui pourraient être utilisés par d’autres… Les ressources dormantes d’un territoire, il en a déjà beaucoup. La nature sait d’ailleurs utiliser 100% des ressources disponibles sur son territoire.
Finalement, est-ce qu’il est souhaitable de rendre le modèle industriel tel qu’il est aujourd’hui « antifragile » si l’on considère qu’il est lui-même en partie responsable de la crise climatique ?
S’inspirer des forêts permet deux choses. Cela permet déjà de rendre le système actuel, que l’on pourrait remettre en cause, beaucoup plus « antifragile ». Au regard de l’impact des aléas climatiques sur la conjoncture mondiale chaque année, on va aller vers une forme de décroissance. On va donc réduire le tempo de l’économie. La question, c’est : comment on amène de la richesse rythmique ? Ça, c’est un premier enjeu de la forêt productive, d’arriver à rendre le système beaucoup plus agile qu’il ne l’est.
Il y a un second enjeu. Une économie beaucoup plus ancrée sur son territoire, une économie avec davantage de synergies, une économie qui est capable d’être beaucoup plus efficiente, c’est une économie qui a beaucoup moins d’impact de CO₂, moins de consommation de matières premières, moins d’impact écologique importé, moins de déforestation importée. Donc, les forêts productives, c’est à la fois une question d’anti-fragilité pour faire face aux enjeux climatiques, mais c’est aussi une question de facilitation de la transition.
C’est l’antidote à l’urgence climatique parce qu’elle sert à la fois l’adaptation et la transition. Elle permet de repenser le fonctionnement économique, peut-être plus décroissant. Si demain on est beaucoup plus contraint par les émissions, mais aussi par les ressources disponibles, on n’aura pas d’autre choix que de repenser une économie qui nous rend plus efficient. Le livre commence par les Cygnes noirs et l’adaptation dans la mesure où l’on n’est absolument pas prêts. Mais ces forêts productives nous permettent aussi de penser des économies qui sont plus à même de faire la transition. Ce sont vraiment ces deux sujets que je porte. D’ailleurs, les forêts productives dont je parle dans le livre sont, certes, une forme d’héritage de l’ancienne économie, mais sont aussi les plus en avance dans la transition.
Un mot pour conclure ?
L’idée du livre, comme on l’a dit en introduction, c’est d’aborder la question climatique sous l’angle économique. Je trouve que tous les débats, toutes les discussions sur la transition et l’adaptation, traitent peu de la manière de repenser notre développement économique. J’adorerais qu’on ait un indicateur de diversité économique qui, pour moi, est aussi important que le niveau du PIB. Ce qui est dommage, c’est que l’on développe avec de bonnes intentions beaucoup de politiques sur les territoires en silo. On va faire des plans de résilience alimentaire, des plans d’économie circulaire, des plans d’écologie industrielle, etc. Ce que j’essaie de montrer dans le livre, c’est que la diversité économique, c’est la condition sine qua non de la réussite de toutes ces politiques. La priorité, c’est de penser la diversification de son tissu. Plus on aura un tissu économique diversifié, plus ce sera facile de développer la transition et l’adaptation. Enfin, la diversification, c’est aussi la meilleure façon de penser au développement des territoires.
Si l’on continue à penser la relation entre économie et climat uniquement par la marchandisation du carbone ou uniquement par une planification écologique qui ne touche qu’à nos transports, notre logement, voire même la production des usines qu’on a actuellement sur le territoire, ça ne suffira pas. Il faut complètement repenser la manière dont on se développe, la manière dont on consomme. Ça, aujourd’hui, c’est complètement absent du débat. C’est pour cela que je voulais écrire ce livre.
À lire aussi :
Les impacts du réchauffement climatique sur l’économie
Comprendre le changement climatique : causes, conséquences et enjeux
Soyez dans le vent 🍃 :
Abonnez-vous gratuitement à la newsletter de Deklic en cliquant ici.