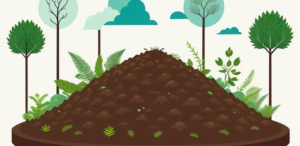En mode climat : « Ce qui explique l’essor d’une mode jetable, c’est l’offre »

En mode climat est un collectif qui oeuvre pour une mode plus responsable.
« Changer les lois, pour que la mode réduise ses émissions de CO2 », le message porté par En mode climat est clair. Des centaines d’entreprises engagées pour une industrie de l’habillement plus responsable demandent à ce que des régulations leurs soient imposées, pour le bien de la planète, des travailleurs et travailleuses, et du secteur en lui-même. Flore Berlingen, responsable plaidoyer au sein du collectif, détricote avec nous le pourquoi du comment.
Quand et comment votre collectif En mode climat est-il né ?
C’est un collectif assez récent qui s’est formé en association l’année dernière. Il a été monté à l’initiative de marques éthiques, et notamment d’une marque qui s’appelle Loom, qui a au départ, lancé une pétition à l’attention des pouvoirs publics pour demander une régulation plus forte du secteur textile, et qui a été suivie par des dizaines et des dizaines d’autres.
L’originalité, c’est que c’est une initiative qui part du monde économique. Le constat qui a été fait par ces acteurs-là, c’est qu’ils essaient de faire bien, de faire mieux, mais qu’ils sont pénalisés sur le marché. En fait, il y a ce qu’on appelle une « prime au vice » qui opère, qui fait que si vous produisez à bas coût, au mépris des considérations sociales ou environnementales, vous êtes récompensé par le marché. Là où, si vous essayez de faire différemment, d’avoir une traçabilité sur votre production et des exigences sociales et environnementales plus fortes, vous prenez un énorme risque compétitif. Vous avez même du mal à exister par rapport à vos concurrents.
Donc, le seul moyen de sortir de tout ça, c’est que les règles du jeu changent, c’est que les exigences sociales et environnementales dont il est question, deviennent obligatoires pour tout le monde. Le collectif s’est constitué comme ça, pour demander un cadre qui permette de lutter contre la fast fashion, un cadre qui permette à l’industrie textile de respecter l’accord de Paris sur les émissions de gaz à effet de serre.
Vous comptez actuellement plus de 600 membres au sein du collectif, qui sont-ils ?
Ce sont des marques, divers acteurs professionnels du secteur textile, parfois aussi des designers, des industries. Même si elles ont en grande partie disparu, il existe encore quelques industries textiles en France et elles font de très belles choses avec des exigences élevées en termes d’environnement, et puis évidemment, une protection des salariés qui est assurée. On a donc aussi quelques membres industriels dans le tissage, dans la confection…

Quels sont vos principaux objectifs ?
C’est de faire reconnaître qu’il faut qu’on remette en question les volumes de production. Pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre du secteur textile, il ne faut pas seulement travailler sur l’éco-conception et la décarbonation de l’industrie, mais il faut aussi travailler sur les pratiques commerciales : marketing, promotion, incitation au crédit, renouvellement permanent des collections, etc.
C’est peut-être aussi ce qui fait la spécificité du combat En mode climat. C’est de poser cette question des volumes, de dire, que même si on est de plus en plus vertueux, il va falloir faire quelque chose sur la quantité qui est mise sur le marché, parce que cette quantité-là n’est pas compatible avec les enjeux environnementaux auxquels on fait face.
Vous vous appuyez sur la science pour partager vos revendications. Que dit-elle de l’industrie textile actuelle ?
La science, en tout cas, l’analyse des données, nous permet de mieux comprendre où se situent les impacts environnementaux du secteur et comment on peut y remédier. C’est notamment cette analyse-là qui nous amène à conclure que si on ne s’attaque pas aux volumes, on ne pourra pas résoudre le problème.
Par exemple, il y a beaucoup d’acteurs qui mettent en avant le fait qu’ils améliorent l’éco-conception et notamment, par exemple, qu’ils utilisent de plus en plus de matières premières recyclées. L’économie circulaire est mise en avant comme étant une solution. La réduction d’impact est intéressante, elle est nécessaire, il faut aller vers de l’éco-conception. Cependant, ça ne compensera pas l’augmentation de la quantité qu’on a vue ces dernières années et qui malheureusement se poursuit.
On va donc s’appuyer sur la science pour revendiquer la prise en compte d’une analyse qui ne soit pas fondée uniquement sur les caractéristiques intrinsèques des produits.
Face à ce constat, quels sont vos principaux leviers d’action ?
Le principal levier d’action, c’est le plaidoyer. Le plaidoyer au sens large, c’est à la fois faire reconnaître les enjeux, par exemple en vous parlant aujourd’hui ou en faisant des petites interventions publiques, mais c’est aussi le plaidoyer au sens plus strict de lobbying direct vis-à-vis, notamment, des décideurs publics. Notre action s’inscrit alors dans le cadre des évolutions réglementaires en cours ou de fenêtres de tir qu’on essaie de créer et de mise à l’agenda des sujets.
Par exemple, il y a le sujet de l’affichage environnemental sur lequel on travaille. On ne pense pas que les choses vont changer parce que les gens seront mieux informés. Malheureusement, on pense que ce ne sera pas suffisant. Néanmoins, on ne peut pas ne pas se mêler de la manière dont est calculé l’impact et la manière dont va se dérouler cet affichage. Donc on se positionne dessus, pour dire qu’il ne faut pas juste prendre en compte l’analyse du cycle de vie, mais aussi les pratiques commerciales des marques.
Sur ce sujet, vous êtes en relation avec le gouvernement et lui faites part de vos propositions ?
Oui, En mode climat a même mené une expérimentation. Il y a eu une phase d’expérimentation ces derniers mois sur l’affichage environnemental du textile où différents groupements ont fait des propositions pour contribuer à la méthodologie de calcul d’impact. En mode climat a activement participé en proposant un indicateur de durabilité extrinsèque.
En gros, au-delà du score d’impact de produits, calculé sur des caractéristiques physiques, on propose d’ajouter un indicateur de durabilité qui prend en compte la fréquence de renouvellement des collections, le pourcentage de décote moyen (c’est-à-dire l’intensité promotionnelle qu’applique la marque), la largeur de gamme (c’est-à-dire le nombre de références qui sont mises sur le marché) et aussi le coût du neuf par rapport au coût de la réparation. On considère en effet que les prix dérisoires sont un frein à la réparation des produits.
À ce propos, le gouvernement prévoit également l’introduction à partir d’octobre, d’un bonus à la réparation des biens textiles. Que pensez-vous de cette mesure ?
Tout ce qui peut encourager la réparation est bon à prendre. Pour autant, on pense que ce n’est malheureusement pas suffisant. Parce qu’il ne faut pas seulement donner un petit coup de pouce aux consommateurs a posteriori, pour les inciter à réparer en soutenant cette action, il faudrait aussi remettre en question le prix de vente initial du produit.
Si le prix d’achat initial est extrêmement bas, est-ce que la personne va faire la démarche de réparer malgré tout ? On n’est donc absolument pas contre ce bonus réparation, c’est très bien. Mais c’est plus un pansement face à une situation qui n’est pas favorable au départ, à la réparation.
Qu’est-ce qui explique, selon vous, cet essor d’une mode jetable depuis quelques années ?
C’est l’offre. Évidemment, il y aura toujours des acteurs qui diront qu’ils s’adaptent à la demande des consommateurs. Le désir des consommateurs est vraiment façonné, et peut-être encore plus pour la mode que pour toute autre industrie. Ce sont des modèles économiques qui sont néfastes et qui créent des besoins de manière artificielle.
Quelles sont les remarques les plus absurdes et récurrentes que vous entendez autour de vous sur la fast fashion ?
Ce n’est pas une remarque absurde, mais en tout cas, c’est une idée reçue qui peut exister. C’est que la fast fashion regrouperait uniquement tout ce qui est de mauvaise qualité. Alors qu’en fait, ce n’est pas forcément le critère qui permet de définir la fast fashion. Vous avez de la fast fashion qui est de bonne qualité. On a tous dans notre armoire un t-shirt H&M qu’on a depuis 15 ans et qui est toujours en très bon état parce qu’il est en polyester et que le polyester, ça ne bouge pas.
Et à l’inverse, un vêtement fragile n’est pas forcément un vêtement de mauvaise qualité. Il y a de très beaux vêtements qui sont fragiles, mais étant donné qu’on en prend soin parce qu’ils ont pu coûter un peu plus cher, ils ne seront pas moins durables, au contraire. Donc, évidemment, il y a le rapport aux vêtements qui rentre en ligne de compte, mais il y a aussi et surtout, la question du prix d’achat. C’est le prix d’achat qui influence notre rapport aux vêtements et notre volonté d’en prendre soin.
Vis-à-vis de cette question du prix, la mode éthique n’est-elle finalement réservée qu’à celles et ceux qui peuvent se le permettre ?
Selon moi, la réponse, c’est de poser la question des quantités. Effectivement, la moyenne annuelle de mise sur le marché de vêtements neufs, c’est une cinquantaine de pièces d’habillement pour chaque Français. C’est énorme et c’est deux fois plus qu’il y a une génération. Donc, c’est sûr que si on fixe la barre à 50, effectivement, il faut vraiment avoir les moyens pour acheter 50 vêtements ou accessoires, « au prix fort ». Entre parenthèses, prix fort qui est plus respectueux des droits humains. C’est un autre débat, mais c’est important de rappeler le fait que, qui dit prix dérisoire, dit qu’on a exploité des gens à l’autre bout de la terre.
En revanche, si on revient à des quantités plus raisonnables, plus compatibles en tout cas avec les ressources disponibles sur notre planète, on a un budget disponible pour chaque achat qui augmente mathématiquement. Et les produits éthiques ne sont pas forcément excessivement chers.
Dès lors, comment changer son rapport à la mode, recréer un lien émotionnel avec ses vêtements et inverser la tendance ?
Le meilleur moyen, c’est de limiter ses achats de neufs et de garder le plus longtemps possible les vêtements qu’on a, de se tourner vers la réparation. Je trouve que la réparation, et notamment l’auto-réparation, favorise aussi le lien, l’attachement aux vêtements qu’on peut avoir. Plus on a travaillé sur un vêtement, plus on va être motivé à le garder longtemps.
Est-il possible, finalement, d’agir à échelle individuelle en ayant réellement un impact ou bien la solution ne peut-elle être que collective ?
Réduire sa consommation, décider de ne pas participer à ce grand gaspillage, c’est forcément positif. C’est valable pour plein d’autres secteurs, pour plein d’autres thématiques. Si on le fait tout seul, c’est un gros coût social. Notamment, peut-être pour les plus jeunes générations, pour qui cela revient parfois à s’exclure un peu volontairement d’un groupe. Renoncer à Shein et à cette mode à petit prix avec une nouveauté permanente, c’est faire un pas de côté qui peut être extrêmement coûteux socialement parlant. C’est pour ça que l’on est convaincu qu’il faut que les réglementations changent.
Selon vous, la mode peut-elle vraiment être responsable ?
Elle peut être responsable dans ses modes de production, ça c’est sûr. Le simple fait de s’assurer que toutes les personnes qui travaillent d’un bout à l’autre de la chaîne du produit sont rémunérées à hauteur au minimum d’un salaire vital, voire plus, c’est être plus responsable que la majorité des marques. On peut être aussi plus responsable sur le plan environnemental. Enfin, une marque peut décider de ne pas faire comme les autres sur le plan commercial. Certaines vont, par exemple, choisir de ne pas faire de promotions ou de ne pas faire de pub par les canaux habituels. Il y a différentes actions et stratégies pour s’éloigner un petit peu du modèle dominant et tout est bon à prendre. Donc oui, il peut exister une mode plus responsable.
Êtes-vous optimiste pour la suite ?
Ce n’est pas évident de répondre. Je suis optimiste quand je vois que le sujet est beaucoup plus sur la table qu’il y a quelques années et qu’on commence à parler des vrais enjeux, de tout ce qu’on a évoqué précédemment. Après, pour l’instant, on n’est pas en train d’inverser la tendance. On n’est même pas en train de ralentir la croissance de la fast fashion. Donc, il y a du boulot !
À lire aussi :